Arts de la table : Plats creux et plats d'autrefois
Pot à oille, terrine, écuelle : ces plats qui portent un nom à la consonance désuète n’ont plus leur place sur nos tables mais plutôt sur une étagère ou dans une vitrine. Mais l’importance qu’ils ont eue autrefois justifie l’intérêt que leur portent les amateurs d’arts de la table. Parmi les pats creux, la saucière devient un objet de collection, tandis que la bonne vieille soupière, après avoir été boudée, revient en force, tout comme le légumier. C’est qu’ils sont sympathiques, ces objets aux formes élégantes et aux rondeurs rassurantes. Certains les utilisent, d’autres détournent leur utilisation pour en faire des cache- pots ou des vide-poches.
Le pot à oille
 Oille viendrait de l’espagnol olla qui désigne une sorte de marmite. C’est un ragoût de viandes diverses accompagné de légumes dont il est fait mention pour la première fois en 1671. Ce mets d’origine espagnole arrive en France à l’époque du mariage de Louis XIV avec l’infante Marie-Thérèse. Au XVIII siècle, époque où la soupière n’a pas encore été inventée, le pot à oille est le plat le plus important : c’est un récipient rond et creux garni d’une doublure amovible pour la facilité du service. Il mesure entre 20 et 30 cm, possède quatre pieds, est pourvu de deux anses latérales et d’un couvercle bombé et repose sur un vaste présentoir appelé aussi dormant. Il est accompagné d’une cuillère à pot ronde en forme de louche. Sous Louis XIV, il est toujours somptueux, en argent, richement orné, c’est l’élément principal du premier service où sont proposés les viandes bouillies et les potages. Il est souvent fabriqué à la paire. Les plus célèbres sont signés Delaunay, Germain, Balzac, Meissonnier, Roettiers, Auguste. Les manufactures de faïence fine ne sont pas en reste. Pont-aux-Choux produit des pots à oille inspirés de l’orfèvrerie, Joseph Hannong à Strasbourg crée des plats en trompe-l’œil, en forme de chou par exemple, et la Veuve Perrin à Marseille les pare de décors d’une grande délicatesse. Sous Louis XVI, le pot à oille s’alourdit et, à partir de l’Empire, il prend une forme plus évasée. Il disparaît à la Restauration, remplacé par la soupière et le légumier.
Oille viendrait de l’espagnol olla qui désigne une sorte de marmite. C’est un ragoût de viandes diverses accompagné de légumes dont il est fait mention pour la première fois en 1671. Ce mets d’origine espagnole arrive en France à l’époque du mariage de Louis XIV avec l’infante Marie-Thérèse. Au XVIII siècle, époque où la soupière n’a pas encore été inventée, le pot à oille est le plat le plus important : c’est un récipient rond et creux garni d’une doublure amovible pour la facilité du service. Il mesure entre 20 et 30 cm, possède quatre pieds, est pourvu de deux anses latérales et d’un couvercle bombé et repose sur un vaste présentoir appelé aussi dormant. Il est accompagné d’une cuillère à pot ronde en forme de louche. Sous Louis XIV, il est toujours somptueux, en argent, richement orné, c’est l’élément principal du premier service où sont proposés les viandes bouillies et les potages. Il est souvent fabriqué à la paire. Les plus célèbres sont signés Delaunay, Germain, Balzac, Meissonnier, Roettiers, Auguste. Les manufactures de faïence fine ne sont pas en reste. Pont-aux-Choux produit des pots à oille inspirés de l’orfèvrerie, Joseph Hannong à Strasbourg crée des plats en trompe-l’œil, en forme de chou par exemple, et la Veuve Perrin à Marseille les pare de décors d’une grande délicatesse. Sous Louis XVI, le pot à oille s’alourdit et, à partir de l’Empire, il prend une forme plus évasée. Il disparaît à la Restauration, remplacé par la soupière et le légumier.
La terrine
 À l’origine, la terrine est, comme son nom l’indique, un plat en terre où l’on cuit les viandes en sauce. Vers 1720, ce plat passe de la cuisine à la table et devient aussi raffiné que le pot à oille. On en trouve des exemples en faïence fine mais beaucoup sont en orfèvrerie. La terrine ressemble au pot à oille en ce sens qu’elle repose aussi sur quatre pieds, s’accompagne d’un présentoir, possède un couvercle amovible et est parfois doublée d’un autre récipient. Mais elle est plus basse et, au lieu d’être ronde, elle est ovale (elle mesure 30 à 40 cm de long). Les poignées et le couvercle sont souvent ornés de scènes de chasse. Son usage reste imprécis, elle semble avoir servi aussi bien aux viandes en sauce qu’à d’autres mets. Elle s’accompagne d’une cuillère à ragoût à cuilleron ovale.
À l’origine, la terrine est, comme son nom l’indique, un plat en terre où l’on cuit les viandes en sauce. Vers 1720, ce plat passe de la cuisine à la table et devient aussi raffiné que le pot à oille. On en trouve des exemples en faïence fine mais beaucoup sont en orfèvrerie. La terrine ressemble au pot à oille en ce sens qu’elle repose aussi sur quatre pieds, s’accompagne d’un présentoir, possède un couvercle amovible et est parfois doublée d’un autre récipient. Mais elle est plus basse et, au lieu d’être ronde, elle est ovale (elle mesure 30 à 40 cm de long). Les poignées et le couvercle sont souvent ornés de scènes de chasse. Son usage reste imprécis, elle semble avoir servi aussi bien aux viandes en sauce qu’à d’autres mets. Elle s’accompagne d’une cuillère à ragoût à cuilleron ovale.
L’écuelle individuelle
 L’ancêtre de notre assiette creuse, l’écuelle, est un bol à fond plat dont la forme est héritée du Moyen Âge. C’est l’un des premiers récipients individuels à apparaître sur la table. Elle est pourvue, dans le courant du XVII siècle, de deux prises latérales appelées oreillons, d’un couvercle amovible pour conserver la chaleur et d’un plateau ou présentoir. La plus prestigieuse est celle du Dauphin, le fils de Louis XIV. Elle date de 1692, est en vermeil, avec des anses ornées de coquilles et de dauphins. Particulièrement adaptée aussi aux accouchées ou aux malades condamnés au bouillon, elle est également offerte en cadeau de naissance, présentée dans un écrin de maroquin. En argent, elle est une spécialité de Strasbourg. Les grandes manufactures en ont fabriqué de nombreux modèles : les célèbres terrines de la manufacture Hannong, de Strasbourg également, en forme de canards, de dindons, d’oies ou de légumes sont remarquables.
L’ancêtre de notre assiette creuse, l’écuelle, est un bol à fond plat dont la forme est héritée du Moyen Âge. C’est l’un des premiers récipients individuels à apparaître sur la table. Elle est pourvue, dans le courant du XVII siècle, de deux prises latérales appelées oreillons, d’un couvercle amovible pour conserver la chaleur et d’un plateau ou présentoir. La plus prestigieuse est celle du Dauphin, le fils de Louis XIV. Elle date de 1692, est en vermeil, avec des anses ornées de coquilles et de dauphins. Particulièrement adaptée aussi aux accouchées ou aux malades condamnés au bouillon, elle est également offerte en cadeau de naissance, présentée dans un écrin de maroquin. En argent, elle est une spécialité de Strasbourg. Les grandes manufactures en ont fabriqué de nombreux modèles : les célèbres terrines de la manufacture Hannong, de Strasbourg également, en forme de canards, de dindons, d’oies ou de légumes sont remarquables.
La saucière
 Au XI siècle, on l’appelle « sausseron » ou « saucier ». Sa forme a relativement peu varié au cours des âges, qu’elle soit en métal ou en céramique. Sous Louis XV, elle a la forme d’une navette ou d’une nef oblongue à deux becs permettant de verser la sauce par les deux côtés ; elle possède deux anses latérales et fait corps avec son présentoir. Vincennes et Sèvres en ont produit de tout à fait charmantes. Sous Louis XVI puis sous l’Empire, les modèles les plus courants sont en forme de lampe antique à huile, en casque ou en gondole sur piédouche, avec un large bec verseur d’un côté et une anse enroulée de l’autre. Au XIXe siècle, elle est fixée sur un plateau pour protéger la nappe et intègre le service de table. Parmi les nombreux modèles de saucières en faïence et en porcelaine, citons la dégraisseuse, qui permet de séparer le gras et le maigre d’une sauce.
Au XI siècle, on l’appelle « sausseron » ou « saucier ». Sa forme a relativement peu varié au cours des âges, qu’elle soit en métal ou en céramique. Sous Louis XV, elle a la forme d’une navette ou d’une nef oblongue à deux becs permettant de verser la sauce par les deux côtés ; elle possède deux anses latérales et fait corps avec son présentoir. Vincennes et Sèvres en ont produit de tout à fait charmantes. Sous Louis XVI puis sous l’Empire, les modèles les plus courants sont en forme de lampe antique à huile, en casque ou en gondole sur piédouche, avec un large bec verseur d’un côté et une anse enroulée de l’autre. Au XIXe siècle, elle est fixée sur un plateau pour protéger la nappe et intègre le service de table. Parmi les nombreux modèles de saucières en faïence et en porcelaine, citons la dégraisseuse, qui permet de séparer le gras et le maigre d’une sauce.
La soupière
Elle apparaît au tout début du XIX siècle. De plus grande taille que le pot à oille, elle lui ressemble cependant : elle est ronde, profonde, et munie d’un couvercle (l’encoche pour la louche n’apparaît qu’au XXe siècle). Sous l’Empire, les grands orfèvres comme Odiot inventent de somptueuses soupières à l’antique, en forme d’urnes montées sur piédouche et ornées de cols de cygnes. À partir de la Restauration, elles
prennent la forme ronde et évasée que nous leur connaissons : les couvercles sont surmontés de boutons pomme de pin, artichaut, tomate et les anses sont creuses. Elle vont souvent par paire, font partie du service et existent en plusieurs dimensions – pour 2,4,6,8,10, 12,15 ou 24 personnes. En argent et en métal argenté, elles sont signées de grands orfèvres du xix’ siècle comme Hugo, Cardeihac, Lebrun, Ravinet d’Enfer, Têtard Frères, Durand. En faïence et en porcelaine, elles ont été déclinées par toutes les manufactures-Montereau, Creil, Sarreguemines, Lunéville, Gien, Saint-Clément, Longwy, Quimper – qui ont fait de cet objet aux rondeurs avenantes se prêtant à tous les décors, un symbole familial et rassurant.
Le légumier
Plus petit que la soupière, le légumier, qui nous viendrait d’Angleterre, se confond parfois avec l’écuelle car il est rond comme elle et pourvu de deux anses latérales et d’un couvercle à bouton représentant une pomme de pin ou un légume. Si le terme n’apparaît qu’au XIX ‘siècle, l’objet est en usage à partir de 1730, souvent produit par paire. Lorsqu’il est fait en orfèvrerie, il est parfois accompagné d’un réchaud.
Un autre type de légumier apparaît au XIX siècle. Il s’agit d’un plat creux rectangulaire dont le couvercle est muni d’un bouton amovible. Une fois le bouton rentré, il ne reste qu’à retourner le couvercle, qui forme alors un second plat.
Les légumiers en faïence et en porcelaine reproduisent en plus petit la forme et le décor de la soupière du service. Parmi les plus prisés, ceux dont les décors évoquent les produits du jardin, comme les artichauts et les carottes ou encore les pommes de pin.
Le ravier
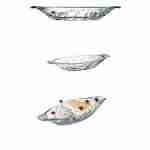 Le mot vient probablement de «rave», nom qui désignait autrefois le radis. Il apparaît en 1830 et sert, donc, pour les hors-d’œuvre. On l’appelle aussi hors d’œuvrer ou bateau à raves lorsque sa forme est allongée et relevée aux deux extrémités. En porcelaine, en faïence, en verre, en cristal et en métal, il est rectangulaire, oblong ou hexagonal. Il peut se présenter aussi sous la forme de plusieurs coupelles mobiles formant compartiments et placées dans une monture avec anse ou poignée centrale en cuivre nickelé ou en métal argenté.
Le mot vient probablement de «rave», nom qui désignait autrefois le radis. Il apparaît en 1830 et sert, donc, pour les hors-d’œuvre. On l’appelle aussi hors d’œuvrer ou bateau à raves lorsque sa forme est allongée et relevée aux deux extrémités. En porcelaine, en faïence, en verre, en cristal et en métal, il est rectangulaire, oblong ou hexagonal. Il peut se présenter aussi sous la forme de plusieurs coupelles mobiles formant compartiments et placées dans une monture avec anse ou poignée centrale en cuivre nickelé ou en métal argenté.
Le saladier
C’est un bol sans anses qui existe depuis le XVIIe siècle. Il sert d’abord à la cuisine et ne prend place sur la table que plus tard. En faïence fine ou en porcelaine, c’est un plat moins courant que le pot à oille ou la terrine. Il faut attendre la fin du xix’ siècle pour qu’il fasse partie intégrante du service de vaisselle. Cependant, en cristal taillé, en porcelaine ou en faïence, il est proposé aussi indépendamment et sert autant pour la salade que pour les fruits et les entremets.
Vidéo : Arts de la table : Plats creux et plats d’autrefois
Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : Arts de la table : Plats creux et plats d’autrefois
https://www.youtube.com/embed/seO4O7FBggg